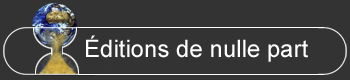C'est à Pierre Somville, un universitaire liégeois (1942), que je dois, dans Penseurs et idéologues - et plus particulièrement à la page 101 du chapitre intitulé Schopenhauer et le paradoxe de l'art - d'avoir attiré mon attention sur le fait que Clément Rosset, dont L'école du réel m'efface de contemplation admirative, avait plus qu'un penchant avéré pour Schopenhauer, et ce dès l'entame de sa carrière de philosophe d'université (Nice).
La citation extraite de Pierre Somville: « Pour le commentaire, en plus des ouvrages incontournables de Clément Rosset...». Il est un des trois philosophes qui me référencent, aux côtés de Spinoza et Jean François Billeter.
Deux recherches plus tard sur l'Internet qui ne garde pas trop de traces de mes questionnements (Firefox + moteur de recherche Duck Duck Go), j'ai engrangé un article rédigé par Mme Margaux Cassan sur un ouvrage de la main de C. Rosset, publié en 2001 intitulé Écrits sur Schopenhauer reprenant trois écrits datant de 1969; l'article dans sa seconde note me révèle un deuxième ouvrage, postérieur (1989) du même C. Rosset sur le philosophe allemand.
Deux réservations de ces ouvrages sur le réseau toujours public de lecture publique de la Province de Liège (en sursis, si l'on en croit les intentions des gouvernements des droites qui sont à la manoeuvre à tous les niveaux de pouvoir en Belgique) concluent provisoirement ma prise de connaissance de sa proposition philosophique.
Ils atterriront sur ma table de travail vers le 7 ou le 8 mai 2025.
Ce sont trois écrits sur Schopenhauer datant de 1969 qui rejoignent en premiers la bibliothèque locale.
« Quand Schopenhauer élabore son esthétique (3e partie du Monde comme volonté et représentation) Hegel inaugure son propre cours d'esthétique à l'Université de Berlin... S'intéressant à la nature de la contemplation esthétique, non à la nature de l'oeuvre contemplée, [Schopenhauer] ne termine ni n'inaugure aucune période de l'histoire de l'art, mais LE PLAISIR QU'IL PROCURE N'EN A PAS, or c'est à ce plaisir seul que s'intéresse Schopenhauer dans sa réflexion esthétique. »
Cet extrait de la préface sous forme d'entretien entre Paul Audi, un des deux directeurs de la collection Perspectives critiques des Presses Universitaires de France, et Clément Rosset date de 2001. L'auteur indique clairement la quête qu'il s'agit d'entreprendre en lisant ces trois écrits sur Schopenhauer.
Schopenhauer (1788-1860) survivra à Hegel (1770-1831), emporté par une épidémie de choléra en 1831.
J'ai choisi d'étoffer le sommaire du troisième écrit, intitulé L'esthétique de Schopenhauer.
147 Introduction
151 I PLACE DE L'ESTHÉTIQUE DANS L'OEUVRE DE SCHOPENHAUER
1. Le contexte philosophique
155 2. Le contexte historique
158 3. Intérêt de la doctrine
1) L'esthétique de Schopenhauer est ce qu'il y a de meilleur, de plus caractéristique et d'original dans l'ensemble de l'oeuvre (lecture traditionnelle)
2) L'esthétique de Schopenhauer appartient à la partie caduque de l'oeuvre
3) Nous proposerons ici une troisième lecture.
160 Vive réceptivité du plaisir esthétique
Un styliste soucieux de sa plume
161 II LES IDÉES DIRECTRICES
1. Art et contemplation
Schopenhauer précurseur: Bergson, Proust, Freud
170 2. L'objectivation de la volonté et la théorie schopenhauerienne des "IDÉES"
176 3. La théorie du beau et du plaisir esthétique. Rapports avec Nietzsche.
185 4. La théorie du sublime
187 5. La théorie du génie & de la création artistique
Théorie de la réminiscence et Hypothèse du sombre précurseur
201 III LA HIÉRARCHIE DES ARTS
1. Principe de la hiérarchie
Loi de la simplicité expressive
203 1) architecture
2) peinture et sculpture chez les paysagistes et les animaliers
3) sculpture: nature humaine considérée dans sa plus grande généralité
4) peinture: nature humaine dans sa plus grande spécificité
5) poésie: nature humaine considérée dans l'exercice de la pensée
6) tragédie: nature humaine considérée dans son aptitude à renoncer à la volonté
204 2. L'architecture
208 3. La sculpture
211 4. La peinture
213 5. La poésie
218 6. La tragédie
223 IV MUSIQUE ET RÉPÉTITION
1.
231 2. Théorie des "universalia ante rem" La musique n'est pas reflet de la volonté mais [la musique est] apparition d'un thème antérieur à la volonté.
236
240 3. Nature de la JUBILATION musicale: Schopenhauer avec et contre Nietzsche: Saturne et Dionysos.
fin