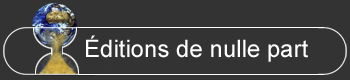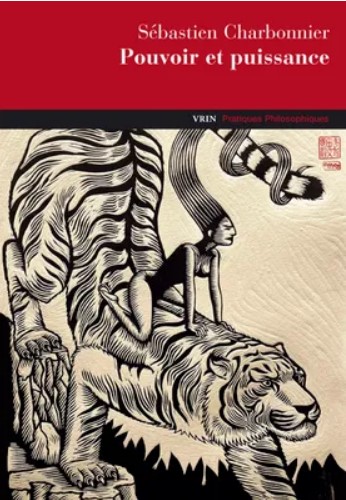 25 09 25
25 09 25
Je dépose pour l'instant ça ici: Sébastien Charbonnier vient de publier "Pouvoir & puissance: refuser de parvenir, une joie pure".
De bric et de broc est ce livre fait.
Ce n'est pas tout à fait un bric-à-brac.
Le MEMENTO que l'auteur a assemblé pour soi
constituerait bien une façon d'y goûter
avant d'y entrer.
Une manière de convenir en soi
s'il sied ou non de s'y attarder.
559 est le nombre de texticules, qu'il nomme, lui, aphorismes, dont l'ouvrage se compose.
La PRÉFACE se structure en quatre sous-titres, non repris dans la table des matières en fin d'ouvrage:
- La pratique comme épreuve de vérité 7
- Des mots, encore & encore 9
- Refuser de parvenir : quatre modalités de mise en pratique (simple, quotidienne, locale & radicalité) 14
- La pratique ou la vie comme déséducation 18
La POSTFACE, elle, est consacrée à quatre modalités des pratiques transformatrices:
- La simplicité (épistémologique)
- La quotidienneté (éthique & politique)
- La localité (écologique & économique)
- La relativité (métaphysique)
Ce qui, vous le constaterez par vous-même, est une reprise de la troisième partie de la préface.
Et puis, bardaf, les quatorze chapitres eux, me perplexifient la vie. Ils sont très rigoureusement décharpentés. Cette rigueur même (dé)force l'admiration...
Même s'ils surgissent en deux salves équivalentes séparées par un Aparté.
- Refuser de parvenir
- Hypothèse: refuser de se rapporter à des ordres
- [Outiller principalement LE maître]
- [Forcer la vie au service des morts]
- Agir au sein d'un milieu, traversé.es par les forces
- [Nullifier les pouvoirs]
- [Diviser socialement le travail] APARTÉ Principe partout, police nulle part
- L'obsession des ordres: montrer du doigt
- Donner à exister
- [Avoir envie d'avoir envie et perdre le désir]
- [Pratiquer sans obliger ni sanctionner]
- Réarmer nos moyens pour en finir avec la démunition
- [Être fasciné par les places/les lieux de pouvoirs]
- [N'en avoir pas fini avec le moi]
[]= J'ai infinitivé les actes comme dans les autres chapitres pour lesquels l'auteur avait procédé de la sorte. La façon dont l'auteur attable ses matières oscille entre le verbe à l'infinitif et la nommaison...
Le charniérage des texticules les uns aux autres est absent. Qu'est-ce qui a prévalu dans la tête de l'auteur pour qu'il place/localise tel paragraphe à tel endroit plutôt qu'à telle autre ? L'absence de liant, de mots liens, est-ce ce qui (me) manque ce qui (me) fait défaut ? L'absence de hiérarchisation entre eux (me) perturbe, il me semble. En tout cas, leur absence a retenu mon attention, parfois au détriment même du sens à attribuer à l'ensemble.
Cette absence de liant/Ce liant absenté entre les 559 texticules constitue-t-il, qualifie-t-il la démarche de l'auteur tout autant que le malaise qui sourd de cette quasi malfaçon ? En est-ce une par ailleurs ? De trancher, je me garderai bien. Crayon en main, parfois à la mine colorée sans colère, j'acquiesce à ce que je parviens à en retirer.
Ce liant qui s'abstient opacifie comment l'auteur a décidé que tel texticule va plutôt ici que là.
La créativité est au rendez-vous. La bibliographie à laquelle l'ouvrage s'adosse est impressionnante. J'y puise matières à penser; certaines références me sont familières: je devrais me sentir en terrain connu. Pas mal de texticules me "parlent", je leur sers de chambre d'échos que je verse dans mon 227e carnet. Mais bon, je ne suis pas sûr de posséder la boite à couture qui m'instrumentera adéquatement pour assembler ces apartés texticulés en messages qui seraient à même de percuter mon entendement de façon synthétique.
Cet auteur, après avoir refusé de contredire, persiste en refusant de parvenir. Du premier refus, je n'avais rien perçu même si je dissertais sur le sens à attribuer au mot ASSENT en anglais.
Sur ce ni/ni, il a construit une Anthropologie de la comédie adulte qui sous-titrera un ouvrage à paraitre le 14 11 25 sous le titre La fabrique de l'enfance.
L'entretien d'une heure & demi qu'il a accordé en septembre 2025 au site Lundimatin s'écoute en suivant ce lien. Le site a également publié un peu avant la parution du livre quelques-uns des 559 texticules.
Je n'ai toujours pas décidé si j'étais équipé pour apprécier cette oeuvre qui se construit sous nos yeux. Se peut-il qu'il faille déjà être construit/déconstruit/reconstruit soi-même pour apprécier ces refus en cascades ? Ce que je sais, par contre, c'est que le néologisme empotenté.e ne passe pas : j'y vois surgir trop aisément l'empoté.e ...
À vous de décider s'il s'agit d'un coup d'épée dans l'eau (la métaphore figure dans l'ouvrage) ou si le jeu (la lecture peut se faire enjouée) en vaut la chandelle pour éclairer les 225 pages de l'ouvrage. Juste ceci: je ne regrette en rien mon achat. La déconcertance/déconcertement est une autre manière de s'engager à penser.