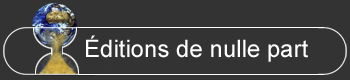Tout ne va pas bien et pourtant nous faisons ce que nous pouvons
Proposition de traduction en français
(J. Mertens à la manoeuvre)
à partir de l'original en néerlandais
de la main de l'autrice, qui est philosophe,
paru dans le n°10 de De Groene Amsterdammer, anno 2025, pages 48 à 50.
Objectif de la traduction:
rendre une position philosophique accessible aux francophones
tout en offrant de manière ramassée
la totalité du raisonnement de l'autrice,
en se dispensant, dans la foulée, de la lecture d'un ouvrage de la même
en anglais et sur presque 200 pages,
puisqu'il n'en existe pour l'instant & à ma connaissance aucune traduction.
Sur HOPEFUL, j'ai rédigé une brève étude terminologique que vous trouverez en cliquant sur le titre.
§1 Le désespoir nous joue un sale tour en ces temps d'incertitude. Mais l'optimisme est-il pourtant un "devoir moral" ? Bon, pas si nous croyons bêtement que tout va aller. L'espoir sans savoir comment s'y prendre est creux et inutile.
§2 En un temps où les démocraties sont menacées t où la droite radicale progresse sur la scène mondiale tandis que les fragiles accords sur le climat se "cassent le figure", il n'est pas étonnant que nous éprouvions un certain désespoir mais nous devons rester optimiste, c'est ce qu'on entend chaque fois. Qu'il s'agisse de la question climatique ou de politique, partout semble s'imposer de terminer avec une note optimiste, comme si chacun·e qui ne le fait pas avait déjà perdu la partie. On cite alors à ce propos Karl Popper qui voyait dans l'optimisme un "devoir moral".
§3 Cela se produit sur tout le spectre du débat politique. Le jour de l'inauguration de D. Trump en janvier de cette année, nous avons entendu Elon Musk parler de l'optimisme comme une des valeurs les plus américaines, tandis que Geert Wilders, le soir des élections aux Pays-Bas, a dit que l'agenda de l'espoir avait gagné.
§4 Mais l'espoir pour qui ? Aux États-Unis, l'air est pour le moment rempli d'espoir mais pour celles & ceux qui sont menacé·es d'être expulsé·es ou pour qui le droit à disposer de leur propre corps menace de leur être ôté.
§5 C'est aussi le cas dans le débat climatique: des chercheurs & chercheuses ainsi que des activistes se voient pour un oui pour un non demander de donner aux gens de l'espoir. Leurs réponses trahissent parfois de l'agacement. "C'est comme si les gens étaient obsédés pas par la question de l'espoir parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire sans", pour citer G. Thunberg dans un entretien. "Mais c'est précisément l'inverse: quand ils agissent, ils créent de l'espoir."
§6 Le risque est que l'espoir devienne un message vide, un bel emballage qui peut être utilisé à de multiples fins, dont certaines très problématiques. Des promesses de neutralité climatique en 2050, ça sonne bien, mais elles sont trompeuses si elles ne s'accompagnent pas de réductions immédiates de nos émissions. "Ils utilisent l'espoir comme une arme puissante pour ralentir les modifications nécessaires et prolonger le business as usual", comme l'a dit G. Thunberg. De tels messages pleins d'espoir sont diffusés dans des publicités de firmes pétrolières et des... de sorte que après le greenwashing, on peut maintenant parler de hopewashing.
§7 Cela signifie-t-il que nous devons laisser naviguer l'espoir ? Pas en soi. Le point que nous devons toujours soulever: espoir pour qui ? Et quelle signification lui donner ?À quel coût pour nous, cet espoir, quelle est sa valeur ?
§8 Dans l'histoire de la philosophie, il y a toujours eu de tous temps beaucoup de scepticisme quant à la valeur de l'espoir. De nos jours, l'espoir est vu comme quelque chose de bon, à moins qu'on ne lui ajoute quelque chose comme faux ou aveugle. Dans l'antiquité, c'était tout le contraire: l'espoir était en principe quelque chose de risqué ou de pas fiable, à moins que ne soit précisé de façon spécifique "j'ai bon espoir". Dans l'ancien mythe d'Hésiode, l'espoir était le seul des maux qui s'échappait de ma cruche de Pandore (& pas de la boîte) - mais pourquoi donc ? Pour aider l'humanité ou pour la punir ? Beaucoup penchaient pour la deuxième explication. L'espoir peut nous induire en erreur ou nous entrainer à des choses qui ne nous sont pas favorables.
§9 L'idée que l'espoir est préférentiellement quelque chose de favorable est relativement récente. Ce n'est que dans la chrétienté, sous le philosophe Thomas d'Aquin qu'il est devenu quelque chose de grande valeur, une vertu même, mais alors selon des conditions strictes. Si un soudard espère sauter par la fenêtre sans dommage ou un général de l'emporter sur un champ de bataille sans prendre de sages décisions, il n'y a là rien de louable. Pour qu'un espoir soit bon il doit être orienté vers quelque chose de valable et s'accompagner de notre disponibilité à contribuer à sa réussite.
§10 De nos jours, nous avons tendance à passer outre ces menaces, ces restrictions. Si un chef d'entreprise espère profiter de la crise climatique ou si un·e dirigeant·e politique espère pouvoir ignorer le changement climatique sans rien faire, cela a beau être un espoir, il n'en vaut pas la peine. C'est la position de Thunberg mais aussi de l'autrice Rebecca Solnit: l'espoir sans action est inutile. "Hope should shove you out of the door." [L'espoir devrait vous pousser dehors.] C'est aussi le point de vue du philosophe & théologien Cornel West:: l'espoir réel doit et peut coûter quelque chose; méfiez-vous de chaque espoir qui survient trop facilement.
§11 Ce point est souvent omis dans la littérature sur le climat. L'espoir est fréquemment associé à des émotions positives: vous y sentir bien. Chaque fois que les activistes reçoivent le même message, soyez plein d'espoir, soyez optimistes ou sinon laissez tomber. Mais des recherches récentes suggèrent que cela pourrait être l'inverse: des attentes visant trop haut et le devoir être optimiste peut également mener au burnout. "S'agripper à l'optimisme mène justement à davantage de désespoir, de burnout & d'apathie dans le mouvement climatique", ainsi s'exprime le philosophe & activiste Anh-Quân Nguyen. Il sit de quoi il parle: comme organisateur de la COP 26 à Glasgow, il a vécu en direct comment une atmosphère d'espoir et d'optimisme est suivie par une large désillusion lorsque les promesses ne sont pas tenues & que les négociations ont capoté.
§12 Par temps ensoleillé, un espoir joyeux reposant sur des attentes positives peut bien fonctionner mais que se passe-t-il quand des nuages sombres s'accumulent & qu'on ne sait pas ce qui va suivre: soleil ou pluie. Si notre espoir repose sur des résultats positifs, des résultats réalisables, comme on va de l'avant lorsqu'ils perdent en visibilité ? Que doivent faire ceux qui se font du mouron pour le climat alors que la collaboration internationale devient de plus en plus incertaine & que les forces contraires s'accumulent sur la scène mondial; alors que les rdv fragiles aux contenus si minces ne tiennent plus qu'à un fil ? Que peuvent les organisations progressistes lorsque l'ordre du jour d'un gouvernement non seulement fait régresser le progrès mais pire le prend impossible ? S'agit-il d'une perte, d'un signe de faiblesse de leur part, d'une défaite à en devenir pessimiste ? Est-ce la fin de l'espoir ?
§13 Il ne doit pas en être ainsi. Il ne règne en effet rien de nécessairement fataliste ou de passif autour du pessimisme. Au contraire: beaucoup de mouvements activistes sont justement apparus suite à une sorte de pessimisme, suite à une disponibilité profonde pour prendre la situation en considération au sérieux. Le pessimisme est dit défini, pour des raisons qui ne sont pas claires, comme la conviction que tout va plus mal, dont il suit une soi-disant parole sage qu'il n'y a dès lors aucune raison d'y remédier, d'agir. Mais pourquoi est-ce qu'elle se profile dans la foulée ? Et, plus important, pourquoi est-ce qu'il n'en va pas de même pour l'optimisme ? Si ce dernier émane de la conviction que ça va aller mieux, pourquoi est-ce que cela pousserait à nous mettre à agir ?
§14 Le vrai problème ne se situe pas dans nos convictions sur le futur, pas dans l'optimisme ni le pessimisme, mais dans le fatalisme: l'idée que le futur est fermé, que le résultat est déjà présent, que nos actes n'ont donc aucun sens. C'est certainement un problème, notamment dans le débat climatique, dans lequel il existe suffisamment de voix fortes qui insistent sur la conclusion qu'agir n'est pas nécessaire, n'est pas possible. Mais ce fatalisme peut prendre deux formes. Il en existe assurément une forme pessimiste ("C'est trop tard, autant abandonner") mais aussi une forme optimiste ("Toout va aller bien, la technologie va nous sauver, nous ne devons rien faire").
§15 Le fatalisme pessimiste est facile à réfuter. Il ne sera jamais trop tard pour intervenir contre le changement climatique, parce que ceci n'est pas du type de crise qui apparait soudainement et qui doit être amoindrie en une fois. Comme l'a formulé l'activiste et écrivain Daniel Sherrel: " Le problème n'est pas binaire comme une guerre nucléaire, il n'est pas question d'un bouton à enfoncer ou non. Même lorsque cela est continuel et inévitable, il y a encore un monde de différence entre 2° celsius et 6° celsius en termes de souffrance humaine ou de chaos généralisé, & chaque bien marginal qui va dans la bonne direction aujourd'hui contribue à enlever un peu de souffrance future." Ici se joue un point démocratique: ce n'est pas à nous (à chacun·e d'entre nous) de décider unilatéralement qu'il est temps de renoncer. Le changement climatique est un problème mondial dont les plus lourds dommages seront supportés par celles & ceux qui ont le moins voix au chapitre. Personne d'entre nous n'a le droit de décider que de leur éviter une souffrance n'en vaut pas la peine.
§16 Mais il est tout autant nécessaire d'intervenir contre le fatalisme optimiste, qui ne trouve pas son assise sur des faits mais plutôt sur une certaine solution de facilité en la combinant avec une insensibilité bien ancrée à l'encontre de parties du monde qui ont moins l'occasion de résister à la tempête à venir. Et c'est là que se cache un rôle à jouer pour le pessimisme: je l'appelle un pessimisme prometteur pour le différencier du fatalisme - et pour indiquer qu'il ne s'oppose pas à l'espoir.
§17 Car, sans tenir compte de mes doutes sur la manière dont l'espoir s'installe dans le débat actuel, je crois qu'il existe un espoir qu'il vaut la peine de cultiver, justement en ces temps sombres. Ceci ne peut consister en une confiance aveugle dans le fait tout va bien se passer, en le fait de ne rien attendre comme résultats positifs, ni une doctrine d'entraide qui insiste sur une émotion molle ne tenant aucun compte de la réalité. Notre espoir ne peut dépendre d'une retombée sous une forme nouvelle ou de succès; nous ne savons pas si nos meilleurs efforts de changement seront couronnés de succès - et nous devons quand même faire ce que nous pouvons.
§18 Dans ceci se cache l'espoir que nous cherchons: un espoir qui prend appui sur DEUX CONDITIONS. La PREMIÈRE est simple: l'avenir est ouvert. Karl Popper, qui a souvent fait cette remarque, est abondamment cité par ces optimistes, mais quand vous le lisez bien le seul qu'il veut réfuter est le fatalisme, càd que le futur est déterminé. "Les possibilités qui se trouvent dans le futur, aussi bien les bonnes que les néfastes, sont illimitées, dit Popper: "Notre position de base ne doit doit pas être: " qu'est-ce qu'il va se passer?" mais "Que devons-nous faire pour rendre le monde un peu meilleur - même si nous savons qu'aussitôt que nous aurons fait ça de futures générations pourront de nouveau tout changer."
§19 Ce type d'incertitude est peut-être le désespoir de l'optimisme, mais elle (l'incertitude) est l'espoir du pessimisme. Tout peut à chaque moment empirer; ça, (les pessimistes le disent depuis des siècles) nous devons le voir de nos propres yeux. Mais l'ouverture qu'offre l'avenir fonctionne dans les deux sns. Une amélioration est possible mais jamais certaine; cela dépend de notre responsabilité, comme l'a dit Popper: "Nous sommes collectivement responsables de ce qui va se passer."
§20 LA DEUXIÈME CONDITION va avec. Pour être vrai un espoir, un espoir valable, il doit prendre assise sur des valeurs profondes comme l'équité. Nous devrions moins demander de récits prometteurs, comme dit Greta Thunberg depuis des années, et, au lieu de cela, considérer la crise climatique comme le test moral ultime, un qui se confronte aux valeurs de l'équité, de la solidarité, de l'intégrité et de l'équité climatique.
§21 Il y a un demi-siècle, l'activiste tchèque Václav Havel a dit plus ou moins la même chose. Deux ans après avoir été libéré de prison pour son activisme politique & quatre ans avant de devenir président du pays pour lequel il s'était battu, il a dit ceci de l'espoir: " L'espoir, dans ce sens profond & fort, n'est pas la même chose que la joie que les choses aillent bien ou une bonne volonté à investir dans des entreprises qui ont une grande chance de connaitre du succès, mais juste une bonne volonté à travailler pour quelque chose parce que cela est bien & pas parce que cela a une chance de réussir." L'espoir selon Havel n'équivaut pas à l'optimisme. Ce n'est pas la conviction que quelque chose va réussir mais la certitude que cela a du sens, indépendamment du résultat.
§22 C'est aussi ce qu'Albert Camus, un pessimiste plein d'espoir à nul autre pareil, a tenté de faire dans son livre La peste. La peste, qui a été lu avec un intérêt renouvelé pendant la pandémie de la Covid mais que nous devrions à nouveau relire le prenant pour toile de fond la crise climatique. Dans ce livre, une maladie mortelle divise la population oranaise en deux camps. Ceux qui gèrent, par exemple en se présentant aux autorités sanitaires, & ceux qui abandonnent, parce que cela n'a aucun sens ou même parce que ce n'est pas mon boulot ou même parce que cela ne m'est pas favorable. Celles & ceux qui choisissent de se manifester ne le font pas pour obéir mais parce que l'alternative est impensable: "L'avantage de ces ustensiles n'était pas si grand, cr ils savaient que c'était la seule chose qu'ils pouvaient faire, cela aurait tout simplement été impensable qu'ils se soient résolus à autre chose." La question que La peste nous pose n'est pas: Pourquoi devrions-nous agir ? mais: comment pouvons-nous ne pas agir ? Comme le dr Rieux le dit dans La peste: quand tu regardes ce que ça coûte, la tristesse et la double, il faut être fou, aveugle ou lâche pour s'y exposer.
§23 Avec La peste Camus voulait rendre sensible combien était puissante la tentation de céder à la corruption morale, & combien il est important de lui faire rempart. "Parce que tout l'a dans les pattes, cette peste, parce que personne, non personne au monde n'y échappe, dit Jean Tanon, un des personnages, à la fin du livre: "Tout ce que je dis c'est que sur cette terre il y a des pestes et des victimes & que tu dois éviter autant que faire se peut de te tenir du côté de la peste." Pour Tanon, comprendre ça c'est le premier pas vers l'action. "Et j'ai donc décidé dorénavant d'être clair en parole & en action & de me hisser sur le bon chemin."
§24 Ces sortes de moments (nous pouvons les appeler des épiphanies)* nous les rencontrons aussi aujourd'hui lorsqu'on écoute des gens qui décident de s'atteler à un but plus grand. Décider n'est pas le bon mot, il s'agir davantage d'un tournant. "Je devais l'essayer, je devais faire quelque chose." C'est ainsi que Jane Goodall décrit le moment où elle sut qu'elle devait s'atteler à défendre les chimpanzés maltraités. "Je ne savais ni quoi ni comment faire, seulement que ne rien faire n'était pas une option." Il n va de même de l'activiste climatique ougandaise Vanessa Nakate: "J'ai commencé à sentir que je devais devenir une activiste pour le climat."
* Note du traducteur: qui apparait, de la famille de phanein faire briller (→phono). La manifestation de Jésus enfant aux rois mages et la fête qui la commémore [aussi jour des Rois] Manifestation de ce qui était caché. (source Le Grand Robert historique)
§25 S'il s'agit d'une forme d'espoir, il ne dépend pas de la chance de succès ou de l'obtention de résultats concrets. Il s'agit d'avoir fait ce que nous pouvions, ce que nous devions faire. C'est aussi un espoir qui ne s'accompagne pas d'un certain désespoir, comme tant d'activistes pour le climat ont dit osciller entre espoir et désespoir.
§26 Et cela en dit long. Comme tout espoir ne pousse pas à agir, tout désespoir n'entraine pas à ne rien faire. Comme le mouvement provo le savait déjà en 1965, la lutte désespérée peut être aussi motivante que son contraire la soumission résignée. Quand quelqu'un vous dit je suis désespérée, il s'agit le plus souvent d'un appel à l'aide, un appel au changement - cela ne peut pas continuer. Le désespoir aussi peut nous ouvrir la porte.
§27 Au final, il ne s'agit pas tant de savoir à quel degré nous espérons ou désespérons, mais il s'agit de responsabilité comme l'a montré l'écrivain indien Amitav Gosh: c'est notre devoir de faire ce que nous pouvons pour l'avenir. Ce sens des responsabilités & notre disponibilité à pousser plus avant sans tenir compte de nos chances de succès est ce qui nous est demandé. Et c'est la raison pour laquelle le pessimisme prometteur n'est pas une contradiction dans les termes mais quelque chose qui peut nous aider à regarder plus loin que nos vulnérabilités, plus loin aussi que notre capacité à être attiré·e par des mots vides et des actes encore plus vides, une valeur fragile pour une époque fragile.